Invest'Aide > Ressources > Guides > Succession
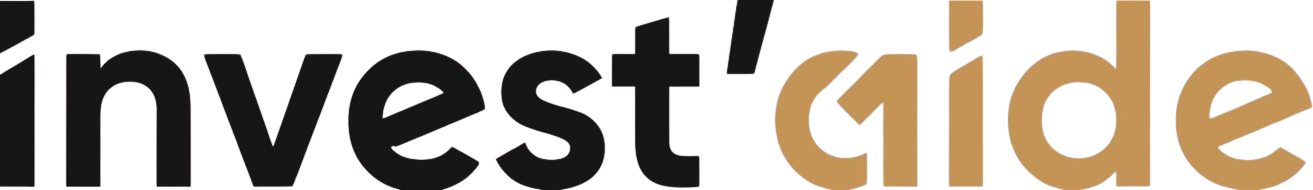
Invest’Aide est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui rend accessibles les stratégies habituellement réservées aux grandes fortunes. Audit patrimonial, accompagnement continu et accès à un large éventail d’actifs (assurance-vie France & Luxembourg, PER, SCPI, immobilier défiscalisant, private equity, produits structurés).
Lorsqu’un proche nous quitte, gérer son héritage et sa succession peut être complexe et chargé d’émotions. Bien que souvent confondus, ces termes ont des significations distinctes. L’héritage désigne les biens, droits et actions laissés par le défunt, tandis que la succession est le processus légal de transmission de ces biens aux héritiers.
En France, ce processus est régi par le Code civil, qui fixe les règles essentielles pour transmettre le patrimoine d’une personne décédée. Comprendre ces principes est indispensable pour éviter les pièges juridiques et émotionnels.
Que vous soyez conjoint survivant, enfant, parent ou autre héritier, il est indispensable de connaître vos droits et devoirs. Ce guide aborde des notions clés comme la déclaration et les droits de succession, la quotité disponible, ainsi que le rôle du notaire.
Face à cette étape difficile, ce guide vous accompagnera pour gérer sereinement les aspects légaux et financiers de la succession.
Les héritiers sont les personnes ayant le droit de recevoir une partie ou la totalité du patrimoine d’un défunt. En France, la loi classe les héritiers en plusieurs catégories, selon leur degré de parenté avec le défunt.
Le premier ordre d’héritiers inclut les descendants, c’est-à-dire les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du défunt. Ces descendants héritent à parts égales et bénéficient de la représentation. Cela signifie que si l’un d’eux est décédé, ses enfants ou petits-enfants peuvent prendre sa place dans la succession.
En l’absence de descendants, les parents ainsi que les frères et sœurs du défunt sont appelés à la succession. Les parents reçoivent chacun un quart de la succession, tandis que la moitié restante est partagée entre les frères et sœurs. Si aucun de ces héritiers n’est présent, les grands-parents, oncles, tantes et cousins peuvent également être appelés à hériter, selon leur degré de parenté.
Il est important de noter que le conjoint survivant dispose également de droits dans la succession, même s’il n’est pas automatiquement l’héritier principal. Sa part d’héritage dépend de la présence ou non d’autres héritiers et est encadrée par le Code civil.
Le testament est un document permettant au défunt d’exprimer ses dernières volontés concernant la répartition de son patrimoine après son décès. Il offre la possibilité de déroger aux règles de succession légale et de désigner des héritiers qui ne figurent pas nécessairement parmi les premiers dans l’ordre de succession légal.
Cependant, il est essentiel de respecter la quotité disponible, qui représente la part du patrimoine que le défunt peut librement disposer dans son testament, sans porter atteinte aux droits des héritiers réservataires (généralement les enfants et, dans certains cas, le conjoint survivant).
Un testament bien rédigé permet d’éviter de nombreux conflits entre les héritiers et garantit le respect des volontés du défunt. Il est souvent recommandé de le rédiger avec l’aide d’un notaire pour s’assurer de sa validité et de sa conformité aux lois en vigueur.
Lorsqu’un décès survient, plusieurs étapes légales doivent être suivies pour gérer la succession. La première étape est l’ouverture de la succession, qui se produit automatiquement au moment du décès. Les héritiers doivent ensuite procéder à la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, généralement dans un délai de six mois suivant le décès.
Cette déclaration permet de déterminer les droits de succession à payer.
Par la suite, les héritiers doivent désigner un notaire chargé de gérer la succession et de veiller au respect des lois ainsi qu’aux volontés exprimées dans le testament, si celui-ci existe. Le notaire joue un rôle clé en répartissant les biens, en gérant les donations et les contrats d’assurance vie, et en s’assurant que tous les aspects fiscaux et légaux soient correctement traités.
Ces étapes sont essentielles pour une gestion harmonieuse et conforme de la succession, permettant aux héritiers de traverser ce processus complexe avec confiance et sérénité.
Lorsqu’un héritier est appelé à une succession, il dispose de plusieurs options concernant l’acceptation de celle-ci. Il peut choisir d’accepter purement et simplement la succession, ce qui signifie qu’il prend en charge l’ensemble des biens et des dettes du défunt.
Cependant, cette option peut être risquée si le passif de la succession (les dettes) est important, car l’héritier pourrait voir son propre patrimoine menacé.
Une autre option est l’acceptation à concurrence de l’actif net. Cette approche permet à l’héritier de n’être tenu des dettes successorales qu’à hauteur de sa part dans l’actif de la succession. Elle offre une protection supplémentaire à l’héritier, car il ne sera pas responsable des dettes au-delà de la valeur des biens qu’il reçoit (article 791 C. civ.).
Enfin, l’héritier peut également refuser la succession, ce qui signifie qu’il renonce à tous les biens et dettes du défunt. Cette décision doit être prise avec soin, car elle est définitive et irrévocable.
Lors de la gestion d’une succession, les héritiers doivent également s’occuper des dettes et des réclamations des créanciers du défunt. Les héritiers peuvent accomplir des actes purement conservatoires, des actes de surveillance ou des actes d’administration provisoire sans être considérés comme acceptants de la succession.
Ces actes incluent, par exemple, le paiement du loyer ou des impôts dus par le défunt.
Si un héritier découvre un passif inconnu de la succession qui menace gravement son patrimoine, il peut demander au tribunal judiciaire de le décharger en tout ou partie de son obligation de paiement. Cette demande doit être introduite dans les cinq mois suivant la découverte de la dette (article 786 C. civ.).
Les héritiers doivent également gérer les comptes bancaires et les biens du défunt. En cas d’indivision, c’est-à-dire lorsque plusieurs héritiers partagent les biens, la gestion peut être plus complexe. Les héritiers peuvent choisir, d’un commun accord, un mandataire qui peut être l’un d’entre eux ou un tiers, pour administrer les biens de la succession.
Le juge peut également désigner un indivisaire comme administrateur de l’indivision (article 815-6 C. civ.).
En cas de mésentente profonde entre les héritiers, un mandataire judiciaire peut être nommé par le tribunal. Ce dernier dispose des pouvoirs nécessaires pour gérer ou même vendre les biens de la succession (article 813-1 C. civ.).
La gestion des biens inclut également la décision de vendre ou de conserver les biens, tels que les propriétés ou les nue-propriétés, ainsi que de gérer les contrats d’assurance-vie qui peuvent faire partie de la succession. Le notaire joue un rôle essentiel dans ces processus, en aidant les héritiers à naviguer à travers les complexités juridiques et fiscales.
Le calcul des droits de succession est une étape essentielle dans la gestion d’une succession. Il se déroule en deux phases : l’application d’un abattement et l’utilisation d’un barème progressif.
Les abattements dépendent du lien de parenté avec le défunt. Par exemple, pour les héritiers en ligne directe (parents, grands-parents, enfants, petits-enfants), l’abattement est fixé à 100 000 €.
Après application de l’abattement, le montant restant est soumis à un barème progressif. Ce barème comporte plusieurs tranches, avec des taux d’imposition variant de 5 % à 45 %, selon la valeur de la part taxable.
Voici un exemple concret : pour une part de succession de 200 000 €, après déduction de l’abattement de 100 000 €, il reste 100 000 € à imposer selon le barème. Les droits de succession calculés sur les différentes tranches aboutissent à un total de 18 193,4 €.
Les donations antérieures jouent un rôle important dans le calcul des droits de succession. En France, les donations effectuées au cours des 15 années précédant le décès doivent être intégrées dans le calcul de la part taxable de l’héritier. Cela signifie que les biens ou sommes déjà transmis par donation sont ajoutés à la part de succession pour déterminer la base imposable.
Ce mécanisme vise à éviter les stratégies de réduction des droits de succession par le biais de donations anticipées.
Certaines situations permettent d’obtenir des exonérations ou des réductions des droits de succession. Par exemple, les contrats d’assurance vie sont généralement exonérés de droits de succession, sauf si le bénéficiaire est un héritier réservataire (enfants, conjoint survivant) et que le contrat a été souscrit après les 70 ans du défunt.
De plus, certaines dépenses, comme les frais funéraires ou médicaux, peuvent être déduites de la base imposable, réduisant ainsi le montant des droits de succession à payer.
Des mesures spécifiques peuvent également alléger la charge fiscale des héritiers, telles que des exonérations pour les personnes handicapées ou des réductions pour les donations réalisées dans un délai particulier avant le décès. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel afin de bénéficier de toutes les exonérations et réductions disponibles et ainsi optimiser le montant des droits de succession.
En résumé, gérer un héritage et une succession en France nécessite de suivre plusieurs étapes importantes et de prendre en compte des aspects essentiels. Il est indispensable de bien identifier les héritiers et de comprendre la répartition des biens selon les règles du Code civil. Le testament peut influencer de manière significative cette répartition, tout comme les donations antérieures et les droits de succession.
Les héritiers doivent faire face à des choix tels que l’acceptation pure et simple, le refus ou l’acceptation à concurrence de l’actif net. Ils doivent également gérer les dettes, les réclamations des créanciers, ainsi que les comptes bancaires et les biens du défunt. Les aspects fiscaux, notamment le calcul et le paiement des droits de succession, ainsi que les exonérations et réductions éventuelles, constituent également des éléments clés à prendre en considération.
Pour finir, il est indispensable de bien se préparer et de solliciter l’aide d’un notaire ou d’un professionnel compétent. Cela permet de garantir que tous les aspects légaux et fiscaux soient correctement traités. Ne laissez pas l’incertitude freiner vos démarches pour protéger votre patrimoine et respecter les volontés de vos proches.
Agissez dès aujourd’hui pour assurer une transition harmonieuse et conforme à la loi de votre héritage.
Les frais de succession pour les héritiers directs (enfants, parents, petits-enfants) sont calculés selon un barème progressif. Voici les taux d’imposition :
La succession après le décès d’un parent suit plusieurs étapes :
Les droits de succession doivent être payés dans les 6 mois suivant le décès.
La différence entre un héritage et une succession réside dans leur portée et leur signification juridique :
La part de chaque héritier dépend de plusieurs facteurs, notamment :
En l’absence de testament, les héritiers reçoivent des parts égales. Par exemple, si l’actif net est de 300 000 € et qu’il y a trois enfants, chaque enfant recevra 100 000 €.
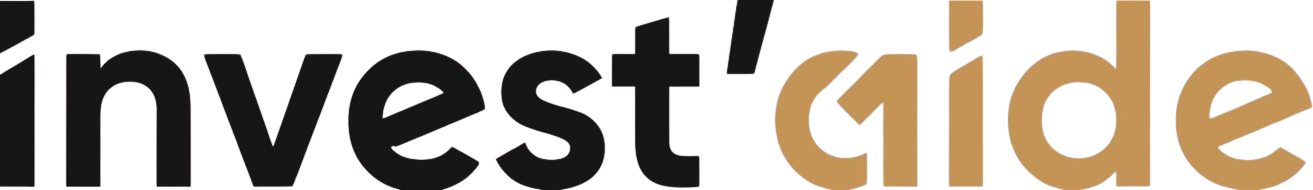
Invest’Aide est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui rend accessibles, dès 50 000 €, les stratégies habituellement réservées aux grandes fortunes. Audit patrimonial, accompagnement continu et accès à un large éventail d’actifs (assurance-vie France & Luxembourg, PER, SCPI, immobilier défiscalisant, private equity, produits structurés).
Découvrez en avant–première nos opportunités d’investissement, nos meilleurs conseils et nos évènements exclusifs.

Société :
SAS 892 754 763 R.C.S. Paris
Siège social : 58 rue de Monceau 75008 Paris
Activités réglementées :
Immatriculée à l’ORIAS n°21001101
Activités : courtage en assurance, conseil en investissement, courtier en crédit
Carte professionnelle :
Titulaire de la carte CPI n°69012021000000014
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans détention de fonds. Délivrée par la CCI de Paris
Adhésion & assurance :
Membre ANACOFI n°E009589
Couverte par une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)
Investir comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Nous sommes disponibles pour vous conseiller sur vos projets d’investissement.
© 2025 invest-aide.fr | Tous droits réservés.